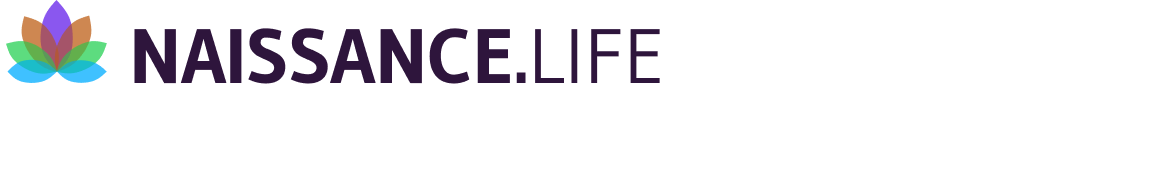Bébé en siège : comprendre, choisir, s'informer pour accoucher en conscience
Ton bébé est en siège ? Découvre dans cet article les options qui s'offrent à toi, en termes de suivi de grossesse et d'accouchement.
Qu'est-ce que la présentation en siège ?
La présentation en siège signifie que ton bébé se positionne fesses ou pieds en bas plutôt que tête en bas dans ton utérus. C'est une variante de position, pas une pathologie.
Il existe trois types principaux de siège :
Siège décomplété (ou siège franc) : les fesses en bas, jambes repliées vers le haut (65-70% des cas)
Siège complet : bébé assis en tailleur, fesses et pieds en bas (environ 30% des cas)
Siège décomplété mode des pieds : un ou deux pieds présentés en premier (10-15% des cas)
À quel moment s'inquiéter (ou pas) ?
Beaucoup de bébés sont en siège au cours du troisième trimestre. C'est tout à fait normal ! La plupart se retournent spontanément avant 37 semaines d'aménorrhée. Seuls 3 à 4% des bébés restent en siège à terme. Parfois il y en a qui se retournent à la dernière minute !
Si ton bébé est encore en siège vers 36-37 semaines, ton équipe te proposera un suivi spécifique et discutera avec toi des différentes options.
Les causes du siège : pourquoi certains bébés restent-ils ainsi ?
Dans la majorité des cas, il n'y a pas de cause identifiable. Ton bébé a simplement trouvé cette position confortable.
Certains facteurs peuvent toutefois favoriser le siège :
Grossesse multiple (jumeaux, triplés...)
Anomalies utérines (utérus bicorne, fibromes...)
Placenta prævia ou placenta en position cornuale
Quantité de liquide amniotique anormale (plus ou moins que la norme)
Prématurité
Certaines malformations fœtales rares
Antécédent de présentation en siège lors d'une grossesse précédente
Important : avoir un bébé en siège ne signifie pas automatiquement qu'il y a un problème. La plupart des bébés en siège sont en parfaite santé.
Diagnostic et suivi de la présentation en siège
Comment sait-on que bébé est en siège ?
Le diagnostic peut être posé de plusieurs façons :
Palpation abdominale lors d'une consultation (manœuvres de Leopold)
Échographie de contrôle, qui confirme la position et permet d'évaluer d'autres éléments importants
Que vérifie-t-on lors du suivi ?
Si le siège est confirmé en fin de grossesse, une échographie complémentaire permet de vérifier :
Le type exact de siège (complet, décomplété...)
La position de la tête fœtale (flexion ou hyperextension)
La quantité de liquide amniotique
Le poids estimé du bébé
La localisation du placenta
L'insertion du cordon ombilical
Ces informations aident ton équipe à t'accompagner dans ton choix de mode de naissance.
Les options pour aider bébé à se retourner
Si ton bébé est toujours en siège vers 34-37 semaines, plusieurs approches peuvent l'encourager à se retourner naturellement.
Méthodes douces et alternatives
Ostéopathie et chiropratique
Ces praticien·nes peuvent identifier et libérer des tensions dans ton bassin, ton utérus ou les structures environnantes qui pourraient empêcher bébé de bouger librement.
Acupuncture et moxibustion
La stimulation du point d'acupuncture Zhiyin (vessie 67, au petit orteil) avec de la moxibustion (bâton d'armoise chauffé) est une technique traditionnelle chinoise. Plusieurs études montrent des résultats encourageants, surtout si pratiquée entre 32 et 35 semaines.
Postures et exercices
Positions d'inversion : à quatre pattes, poitrine vers le sol, fesses en l'air
Pont inversé : allongée sur le dos, bassin surélevé avec des coussins
Exercices Spinning Babies : série de postures et mouvements conçus pour optimiser la position du bassin et de bébé
Marcher dans les escaliers (y compris à reculons, doucement !)
Ces postures visent à créer plus d'espace et à encourager bébé à pivoter naturellement. Pratique-les plusieurs fois par jour, en douceur, et arrête dès que tu ressens un inconfort.
Haptonomie et communication avec bébé
Parler à ton bébé, lui expliquer ce qui se passe, l'inviter (sans forcer) à se retourner peut sembler simple... mais c'est souvent très efficace ! L'haptonomie permet d'entrer en contact affectif avec bébé et parfois de l'accompagner dans ses mouvements. Ton·ta partenaire peut également participer en parlant près de ton ventre, du côté où on souhaiterait que la tête se positionne.

La version par manœuvre externe (VME)
La VME est une technique médicale proposée généralement entre 36 et 38 semaines. Un·e obstétricien·ne tente de faire pivoter ton bébé de l'extérieur, à travers ton ventre, pour le remettre tête en bas.
Conditions pour proposer une VME :
Grossesse unique
Absence de contre-indication (placenta prævia, rupture des membranes, anomalie fœtale sévère, cicatrice utérine récente dans certains contextes)
Disponibilité d'un plateau technique pour surveiller bébé et intervenir si nécessaire
Le taux de réussite est variable selon les équipes et les conditions, généralement entre 40 et 60%. Les chances sont meilleures si :
Tu as déjà accouché par voie vaginale
Bébé a déjà été tête en bas auparavant
Il y a suffisamment de liquide amniotique
La VME est réalisée avant 37-38 semaines
Important à savoir : Même après une VME réussie, environ 5% des bébés se retournent à nouveau en siège avant la naissance.
Risques et inconfort :
La VME peut être inconfortable, voire douloureuse pour certain·es
Risques rares mais réels : décollement placentaire, ralentissement du rythme cardiaque fœtal, déclenchement du travail (d'où l'importance de la réaliser en structure hospitalière)
Certaines maternités proposent une péridurale ou une analgésie pour faciliter la procédure et détendre l'utérus
Tu as le droit de refuser ou d'arrêter en cours de route. Si la VME te met mal à l'aise, tu peux demander à ce qu'on arrête, même après une minute. Écoute-toi.
Réflexion importante : Si ton bébé ne se retourne pas malgré toutes les tentatives, il peut y avoir une raison (anatomique, cordon court, position du placenta...). Certaines mères témoignent avoir regretté d'avoir insisté sur la VME alors que leur bébé "savait" peut-être ce qui était le mieux pour lui.
Accoucher avec un bébé en siège : les options
Si ton bébé reste en siège à terme, tu as le choix entre :
Une tentative d'accouchement par voie basse (AVB)
Une césarienne programmée
Ce choix t'appartient, après information complète des bénéfices et risques de chaque option.
Accouchement physiologique par voie basse en siège
Oui, c'est possible. Et dans de bonnes conditions, avec une équipe formée, c'est une option sûre.
Conditions recommandées par le CNGOF (2020) pour envisager une voie basse :
Siège complet ou décomplété franc (pas de siège des pieds instable)
Poids estimé du bébé entre 2,5 et 3,8 kg (certaines équipes acceptent des variations)
Absence d'hyperextension de la tête fœtale
Bassin maternel adéquat*
Travail spontané à terme (le déclenchement reste possible dans certaines conditions)
Équipe formée, disponible 24h/24, avec possibilité de césarienne rapide si besoin
* La pelvimétrie est parfois proposée, mais de moins en moins recommandée car le bassin n'est pas une structure fixe : il bouge, s'ouvre et gagne en souplesse durant l'accouchement grâce à l'imprégnation hormonale et selon les positions adoptées. Un examen réalisé debout ou allongée, immobile et hors contexte hormonal, n'est donc pas représentatif de ce qui se passera pendant le travail
Points importants à savoir :
La nulliparité (première grossesse) n'est pas une contre-indication à la voie basse
Un antécédent de césarienne n'est pas automatiquement une contre-indication
Le siège complet n'est pas une contre-indication
Un bébé petit pour l'âge gestationnel (PAG ou RCIU - retard de croissance intra-utérin) peut constituer une contre-indication : les bébés en retard de croissance ont plus de risques de souffrance fœtale pendant le travail et de complications lors de la sortie de la tête en siège. Cette situation nécessite une évaluation individualisée
Le protocole OptiBreech : une approche innovante
Le protocole OptiBreech, développé au Royaume-Uni, propose une prise en charge collaborative et physiologique des naissances en siège. Il repose sur :
Un accompagnement par une équipe spécialement formée (sage·femme spécialisée + obstétricien·ne)
Un consentement éclairé et une prise de décision partagée
Une approche personnalisée qui ne se limite pas au poids ou à l'âge gestationnel
Des positions verticales et la liberté de mouvement pendant le travail
Le respect de la physiologie de la naissance en siège
Les données préliminaires d'OptiBreech montrent des résultats encourageants en termes de sécurité et de satisfaction des femmes.
Positions et accompagnement pendant le travail
Contrairement aux idées reçues, tu n'es pas obligée de rester couchée sur le dos. Cela est même contre-productif, notamment pour d'un bébé en siège.
Positions recommandées :
Accroupie : favorise l'ouverture du bassin et la descente de bébé
Debout ou semi-assise : permet à la gravité d'aider
À genoux, corps redressé
Si tu es couchée : jambes en "chasse-neige" (genoux ouverts, pieds rapprochés)
Le quatre pattes peut être moins efficace en cas de siège car il faut une bonne pression pour aider à la dilatation du col (car il n'y a pas la tête en bas pour exercer cette pression). Les positions verticales sont généralement privilégiées.
Péridurale ou pas ?
C'est ton choix ! La péridurale n'est pas obligatoire pour un accouchement en siège. Certaines équipes la recommandent pour pouvoir intervenir rapidement si besoin, d'autres respectent le choix d'un accouchement physiologique sans péridurale.
Dans tous les cas, pour la réussite d'un projet d'accouchement par voie basse il faut privilégier la liberté de mouvements et de positions. La gravité compense le manque de pression qui serait habituellement exercé par la tête sur le col. Donc, si tu penses prendre une anesthésie, informe-toi en amont avec l'équipe médicale sur les différentes solutions compatibles avec cette liberté.
Césarienne programmée : ce qu'il faut savoir
La césarienne est souvent présentée comme "la" solution sécuritaire en cas de siège. C'est une option, mais elle a aussi ses risques :
Récupération post-partum plus longue et plus difficile (hospitalisation prolongée, douleurs, fatigue)
Risque accru de complications lors de grossesses ultérieures : placenta accreta, placenta prævia, rupture utérine
Séparation mère-bébé dans les premières heures (bébé emmené en salle de réanimation pendant la suture)
Impact possible sur l'allaitement (démarrage parfois plus difficile)
Risques chirurgicaux : infection (endométrite, infection de paroi), hémorragie, complications anesthésiques, lésions vésicales ou intestinales (rares)
Risque de détresse respiratoire transitoire du nouveau-né (plus fréquent en césarienne programmée avant travail)
Mortalité maternelle accrue : les études montrent un risque de morbidité maternelle sévère 3 fois plus élevé en césarienne programmée qu'en accouchement vaginal planifié (27,3 vs 9,0 pour 1000 accouchements). Le risque de mortalité maternelle est également augmenté avec la césarienne
Risques à long terme : douleurs chroniques, adhérences, complications digestives, impact psychologique
La césarienne n'est pas anodine. C'est une chirurgie abdominale majeure. Elle doit rester une option réfléchie, pas automatique.

Le vrai problème : le manque de formation des professionnel·les
Aujourd'hui, refuser un accouchement par voie basse en siège sous prétexte qu'on "ne sait pas faire", c'est faire porter à la femme enceinte les conséquences d'une incompétence institutionnelle.
Depuis le Term Breech Trial (2000), les accouchements par voie basse en siège ont quasiment disparu dans de nombreuses maternités. Résultat : les professionnel·les ne sont plus formé·es, et les femmes n'ont plus le choix.
Pourtant, des programmes comme Shawn Walker (UK), Breech Without Borders (USA) ou OptiBreech (Europe) montrent que former les équipes change tout :
On redevient compétent·es
Les taux de césarienne, et ses risques associés, baissent significativement
Les familles retrouvent un vrai choix
5% des sièges sont découverts seulement au moment du travail, parfois à dilatation complète. Si personne ne sait accompagner un accouchement en siège, que fait-on ? Césarienne en urgence et panique... ou accouchement serein avec une équipe formée ?
Le rôle essentiel du·de la partenaire et l'importance de la préparation
Face à un siège, tu ne dois pas être seul·e. Ton·ta partenaire a un rôle fondamental : te soutenir, défendre ton projet de naissance et être présent·e émotionnellement.
Comment le coparent peut-il se préparer ?
S'informer en amont sur les options, les protocoles, les questions à poser à l'équipe
Participer aux rendez-vous médicaux pour être acteur·rice des décisions
Apprendre les positions d'aide pendant le travail
Préparer les questions à poser à la maternité (protocole siège, équipe formée, possibilité de voie basse...)
Avec une préparation adéquate, il pourra être le gardien de la naissance : protéger l'intimité, rappeler les souhaits de la mère, filtrer les interventions non désirées.
Un·e partenaire bien préparé·e peut faire toute la différence entre un accouchement où tu te sens accompagnée et respectée, et un accouchement où tu te sens dépossédée de tes choix.
Pour les futurs pères qui souhaitent se préparer en profondeur, des programmes audio comme "Gardiens de la Naissance" offrent un accompagnement ciblé pour comprendre leur rôle, gérer leurs émotions et devenir de véritables soutiens pendant la grossesse et la naissance.
Avantages
liste
Inconvénients
liste
Questions à poser à ton équipe médicale
Voici quelques unes questions essentielles à aborder avec ta sage-femme :
Quelle est votre expérience des accouchements en siège par voie basse ?
Proposez-vous la VME ? À quel moment ? Avec quelles conditions ?
Quels sont vos critères pour accepter une tentative de voie basse en cas de siège ?
Quelle est votre politique concernant la péridurale en cas de siège ?
Y a-t-il une sage-femme ou un·e obstétricien·ne spécialisé·e en naissance en siège dans votre équipe ?
N'hésite pas à télécharger la checklist des questions à poser à la maternité, afin de t'assurer que leurs équipes sont assez formées pour t'accompagner dans un projet d'accouchement physiologique d'un bébé en siège.
Tu as le droit de changer de maternité à tout moment si celle que tu as choisie ne peut pas respecter ton projet de naissance.

Après la naissance : soins et surveillance
Que ton bébé naisse par voie basse ou par césarienne, les soins postnataux sont similaires :
Pour bébé :
Peau-à-peau immédiat (même après césarienne, si possible)
Surveillance de la respiration, de la température, du tonus musculaire
Examen des hanches (risque légèrement accru de dysplasie en cas de siège, quelle que soit la voie de naissance)
Soutien à l'allaitement dès que possible
Pour toi :
Surveillance post-partum standard (saignements, tension, température)
Si césarienne : soins de la cicatrice, surveillance de la reprise du transit, analgésie adaptée
Soutien émotionnel et physique pour la récupération
Astuce post-césarienne : Si tu as accouché par césarienne, sache que ton bébé n'a pas bénéficié du passage par le vagin et de l'ensemencement naturel par ta flore vaginale. Certaines études suggèrent qu'on peut aider à développer sa flore intestinale en lui faisant téter un doigt propre que tu auras inséré dans ton vagin juste après la naissance (même en présence de lochies). Cette pratique, bien que peu connue, est parfois proposée dans certains hôpitaux sous forme de prélèvements vaginaux.
Ton droit de choisir, toujours
Ton bébé est peut-être en siège. Mais toi, tu es toujours en position de choisir.
Tu as le droit de refuser la VME
Tu as le droit de demander des méthodes douces en priorité
Tu as le droit de tenter une voie basse si les conditions le permettent
Tu as le droit d'accoucher sans péridurale, même en siège
Tu as le droit de bouger, de choisir tes positions, de ne pas rester couchée sur le dos
Tu as le droit de demander un transfert vers une maternité plus expérimentée
Tu as le droit de dire non à tout moment
Un bébé en siège, c'est une variante normale, pas une pathologie. Et c'est surtout ton corps, ton bébé, ton choix.
Afin de travailler sur ton projet de naissance, n'hésite pas à tester le générateur disponible sur ce site, qui inclut toute une partie dédiée au cas des bébés en siège.
Afin de mettre toutes les chances de ton côté, tu peux aussi découvrir le programme dédié proposé sur KaiZen'Nina.
Questions fréquentes sur la présentation en siège
Non ! C'est très fréquent. La majorité des bébés se retournent spontanément avant 37 semaines. Inutile de s'inquiéter à ce stade.
Dans la grande majorité des cas, non. Le siège est souvent une simple variante de position sans cause identifiable.
Cela dépend des personnes. Certaines la trouvent juste inconfortable, d'autres douloureuses. Tu peux demander une analgésie ou une péridurale, et tu peux arrêter à tout moment.
Oui, c'est tout à fait possible si c'est ton souhait et que l'équipe est d'accord. La péridurale n'est pas obligatoire pour un accouchement en siège.
C'est plus nuancé qu'on ne le pense. Les études montrent que :
Le risque de mortalité périnatale est légèrement plus élevé en voie basse planifiée (environ 2/1000) qu'en césarienne programmée (environ 0,5/1000), mais reste très faible dans les deux cas. À titre de comparaison, le risque en présentation céphalique est d'environ 1/1000.
Le risque de morbidité néonatale à court terme (Apgar bas, traumatisme, détresse respiratoire) est augmenté en voie basse
Mais : avec une sélection appropriée des patientes et une équipe formée, la voie basse peut être presque aussi sûre que la présentation céphalique
Et surtout : la césarienne comporte des risques maternels significativement plus élevés (morbidité maternelle sévère 3 fois plus élevée, risque de mortalité maternelle augmenté, complications à long terme)
Le choix doit donc tenir compte à la fois des risques pour bébé ET des risques pour toi.
Non. Beaucoup de maternités programment automatiquement une césarienne. C'est pourquoi il est important de te renseigner et, si besoin, de choisir une maternité qui respecte ton projet.
Le risque de dysplasie de hanches est légèrement augmenté en cas de siège, indépendamment du mode de naissance. La césarienne ne protège pas de ce risque. Un examen clinique et parfois une échographie des hanches seront proposés après la naissance.
C'est très rare et déconseillé par la plupart des recommandations. Le siège nécessite une surveillance et la disponibilité d'une équipe formée et d'un plateau technique en cas de besoin. Discute-en avec une sage-femme spécialisée.
Sources
Recommandations officielles françaises et internationales
CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français). Présentation du siège - Recommandations pour la pratique clinique. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 2020, Vol. 48, N°1.
RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists). Management of Breech Presentation. Green-top Guideline No. 20b, 2017.
ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists). Mode of Term Singleton Breech Delivery. Committee Opinion No. 745, 2018 (réaffirmé 2024).
Protocole OptiBreech et études récentes
Walker S., Spillane E., Stringer K., et al. The feasibility of team care for women seeking to plan a vaginal breech birth (OptiBreech 1): an observational implementation feasibility study. Pilot and Feasibility Studies, 2023.
Walker S., Das S., Stringer K., et al. How safe is it to plan a vaginal breech birth with OptiBreech collaborative care? Analysis of cumulative data within the OptiBreech Multiple Trials Cohort. NIHR Open Research, 2023.
Walker S., Spillane E., Stringer K., et al. OptiBreech collaborative care versus standard care for women with a breech-presenting foetus at term: A pilot parallel group randomised trial to evaluate the feasibility of a randomised trial nested within a cohort. PLOS ONE, 2023.
Term Breech Trial et critiques
Hannah ME, Hannah WJ, Hewson SA, et al. Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial. Term Breech Trial Collaborative Group. The Lancet, 2000.
Glezerman M. Five years to the term breech trial: the rise and fall of a randomized controlled trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2006.
Whyte H, Hannah ME, Saigal S, et al. Outcomes of children at 2 years after planned cesarean birth versus planned vaginal birth for breech presentation at term: the International Randomized Term Breech Trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2004.
Épidémiologie et statistiques
Toijonen AE, Heinonen ST, Gissler MVM. A comparison of risk factors for breech presentation in preterm and term labor: a nationwide, population-based case-control study. Archives of Gynecology and Obstetrics, 2020.
Hickok DE, Gordon DC, Milberg JA, et al. The frequency of breech presentation by gestational age at birth. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1992.
Version par manœuvre externe
Cluver C., Gyte GML, Sinclair M., et al. Interventions for helping to turn term breech babies to head first presentation when using external cephalic version. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015.
Hutton EK, Hofmeyr GJ, Dowswell T. External cephalic version for breech presentation before term. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015..
Impey LWM, Murphy DJ, Griffiths M, Penna LK. External cephalic version and reducing the incidence of term breech presentation. RCOG Green-top Guideline No. 20a, 2017.
Risques comparés césarienne vs voie basse
Liu S., Liston RM, Joseph KS, et al. Maternal mortality and severe morbidity associated with low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery at term. CMAJ (Canadian Medical Association Journal), 2007.
Gutiérrez-Aguirre CH, Esquivel-González M, Calva-Rodríguez RG, et al. Maternal and fetal risks of planned vaginal breech delivery vs planned caesarean section for term breech birth: A systematic review and meta-analysis. Journal of Global Health, 2022.
Hofmeyr GJ, Hannah M, Lawrie TA. Planned caesarean section for term breech delivery. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015.
Contre-indications et critères de sélection
van Dijk MR, Papatsonis C, Ganzevoort W., et al. Contraindications in national guidelines for vaginal breech delivery at term: Comparison, consensus, and controversy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2024.
Macharey G., Gissler M., Rahkonen L., et al. Breech presentation at term and associated obstetric risks factors - a nationwide population based cohort study. Archives of Gynecology and Obstetrics, 2017.
Azria E, Le Meaux JP, Khoshnood B, et al. Factors associated with adverse perinatal outcomes for term breech fetuses with planned vaginal delivery. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2012.
Ressources complémentaires
Breech Without Borders - Organisation internationale de formation et recherche sur les naissances en siège.
Breech Birth Network (UK) - Réseau britannique de formation et soutien aux naissances physiologiques en siège.
OptiBreech UK - Protocole et recherche sur l'accouchement physiologique en siège.
Evidence Based Birth - Synthèses de recherche sur la présentation en siège et les options de naissance.
Photos : Mart Production / Pexels, Yankrukov / Pexels, Patricia Prudente / Unsplash, Amit Gaur / Unsplash
Article référencé dans le wiki de la naissance
Ces articles ont vocation à être collaboratifs : si tu as remarqué une erreur ou si j'ai oublié des informations importantes, n'hésite pas à me le dire via le formulaire de contact.
CATÉGORIES
Cet article t'a plu ?
Alors tu vas adorer les lettres que j’envoie de temps en temps où j'approfondis des sujets partagés sur ce site !
⚠️ Avertissement important
Je ne suis ni médecin ni sage-femme et je ne pratique aucun acte médical. Les informations que tu trouveras sur ce site et sur le générateur de projet de naissance sont là pour t’accompagner, t’informer et te rassurer pendant ta grossesse, ton enfantement et ton post-partum, mais elles ne remplacent jamais l’avis d’un professionnel de santé.
Si tu as le moindre doute, un symptôme inquiétant ou une situation urgente, n’hésite pas à contacter ton médecin, ta sage-femme ou un autre professionnel qualifié.